La fĂȘte est-elle toujours un gaspillage ?
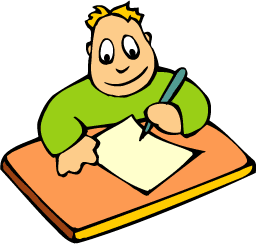 Sujets / Divers / Autres sujets.. /
Sujets / Divers / Autres sujets.. /
Un début de problématisation ...
ProblĂšme :la fĂȘte est aussi bien considĂ©rĂ©e dâun point de vue positif que nĂ©gatif. Le divertissement chez Pascal est une notion qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e. Lâhomme se divertit pour ne pas avoir Ă penser⊠pour ne pas rĂ©flĂ©chir Ă sa condition dâĂȘtre mortel !Pour Nietzsche au contraire la fĂȘte se rĂ©flĂ©chit dans un concept dyonisiaque dont la connotation est positive.
Il sâagit de voir si vous souhaitez soutenir que la fĂȘte est quelque chose de plus souvent positif ou non, si vous penser que par essence elle est positive ou non, si elle est un gaspillage de temps, qui nous est comptĂ©, puisque nous sommes mortels comme le soutient Pascal ou non.
Commencer par traiter du pt de vue avec lequel vous nâĂȘtes pas dâaccord. Ensuite, prenez lâautre en montrant les insuffisances du premier.
Nâoubliez pas de nuancer votre propos, en montrant que la fĂȘte peut certes ĂȘtre un gaspillage de temps, si elle devient une seule finalitĂ© de vie, mais quâelle ne lâest pas toujours et quâelle peut aussi revĂȘtir des aspects positifs.
Bon courage !
A savoir
. La leçon que la Nature nous donne est la sagesse de lâimmortelle simplicitĂ© de ce qui est dans la circularitĂ© du temps. « LâĂ©toile retourne, lâĂ©toile sait, lâĂ©toile se conduit avec intelligence sur un chemin sans vanitĂ©. Elle ne sâĂ©lance pas Ă©perdument et âarrive qui peutâ. Elle accomplit ». La sagesse est sans hĂąte ni vanitĂ©, sans ailleurs et sans demain. Elle est ici. Comme le dit en commentaire AgnĂšs Landes : « Les jours sont ronds dâune divine rondeur, dans la mesure oĂč ils proposent Ă chaque homme une somme de joie Ă savourer, et non pas des buts Ă atteindre ou des actes Ă accomplir. La linĂ©aritĂ© reprĂ©sente la fuite hors de soi, tandis que la circularitĂ© dĂ©bouche sur le bonheur et lâaccomplissement ». Toute la folie humaine tient dans la tension linĂ©aire vers un futur, vers un lendemain que lâon promet toujours glorieux, comme toute sa volontĂ© de puissance. Dans Triomphe de la vie, Giono voir dans la civilisation technique « une ligne droite imperturbablement dardĂ©e vers quelque inconnaissable hauteur sans air ni lumiĂšre ». Le « progrĂšs » ! Lâair et la lumiĂšre sont ici. La fĂȘte de la Vie est ici dans la modestie des petites choses, des joies simples dâune humanitĂ© modeste. Le sens rĂ©el de la fĂȘte est paysan. « Les origines de la fĂȘte paysanne sont faciles Ă comprendre : elles sont dans lâĂ©motion que tout homme sain ressent devant un tas de blĂ©, une rĂ©cole quelle quâelle soit, et dans le sentiment de sĂ©curitĂ© et de paix qui naturellement lâaccompagne ». Parce que la fĂȘte est inscrite dans lâĂ©panouissement joyeux de la rondeur de la Vie. « Le paysan savait ĂȘtre en fĂȘte⊠le pauvre homme des villes est un paysan qui a tout perdu », qui a perdu la rondeur du temps. Alors cet homme de la postmodernitĂ© se paye de spectacles sans joie vraie, il remplit sa vie avec la poursuite de plaisirs qui ne sont que des leurres, des leurres qui le laissent amer et insatisfait. Câest pour cette raison profonde, que les danses folkloriques traditionnelles ont toujours un caractĂšre pĂ©tillant et joyeux, quâelles donnent envie de sautiller et de se laisser porter. Elles sont parentes du jour, de l'espace et de la LumiĂšre. Câest pourquoi la danse en boite de nuit a souvent un caractĂšre sinistre, glacĂ©, rigide. La rigiditĂ© de ces hommes stressĂ©s qui sont comme des pantins dĂ©sarticulĂ©s, des pantins qui sâagitent, mais ont perdu la communion joyeuse, dionysiaque avec la Vie.
Les sortilĂšges de Dionysos
Comment Nietzsche conçoit-il Dionysos ? L'avant-dernier paragraphe de Par delĂ le bien et le mal, Ă©voque le temps de sa jeunesse oĂč Dionysos s'est imposĂ© Ă Nietzsche. En 1864, ĂągĂ© de vingt ans, Nietzsche adressait un poĂšme "au dieu inconnu". Mais, un an plus tĂŽt, il avait dĂ©jĂ offert ses prĂ©mices Ă Dionysos.
Sur sa conception de Dionysos, Nietzsche n'est pas trĂšs prĂ©cis. Il se plaĂźt Ă confondre toutes les lĂ©gendes entourant cette divinitĂ©. TantĂŽt, il renvoie aux mystĂšres d'Eleusis en usant, mĂ©taphoriquement, de la rĂ©fĂ©rence schillerienne-beethovenienne avec l'allusion Ă l'Hymne Ă la joie de Schiller, formant la partie chorale de la NeuviĂšme symphonie de Beethoven. Or, les MystĂšres d'Eleusis racontent l'histoire de DĂ©mĂ©ter, au moment oĂč elle a interrompu son jeĂ»ne en buvant un breuvage au pavot et son deuil en souriant aux plaisanteries de JambĂ©. Ce MystĂšre comportait un double symbolisme de vie et de mort : d'une part, la chute du blĂ© dans le sillon et celle de l'Ăąme dans la mort; d'autre part, la rĂ©surrection du grain dans la moisson et celle de l'homme dans la vie d'outre-tombe. TantĂŽt, Nietzsche se rĂ©fĂšre Ă l'orphisme. Dionysos-Zagreus est alors le symbole de la vie universelle : Ă ce titre, il a Ă©tĂ© dĂ©membrĂ© et, ayant abandonnĂ© la vie, est revenu Ă la vie. En principe, le caractĂšre orgiastique est Ă©tranger aux MystĂšres. Et Nietzsche en Ă©tait parfaitement informĂ©. Dionysos devient mĂȘme, dans l'interprĂ©tation de Nietzsche, "l'infaillible justicier" (section 19 de la N.T.).
Deux types d'ivresse renvoient Ă deux caractĂšres diffĂ©rents quant Ă la personnalitĂ© de Dionysos. Au premier degrĂ©, l'ivresse peut ĂȘtre comprise, comme elle Ă©tait pratiquĂ©e dans la tribu des Satrai en Thrace. Il s'agissait alors de l'effet de l'absorption d'une boisson fermentĂ©e, dont l'exemple est explicitement donnĂ© par la peinture d'un vase d'un Catalogue du British Museum (Catalogue E.439, planche XV) montrant un dieu sauvage, dansant dans un Ă©tat de violente Ă©briĂ©tĂ©. MĂȘme alors, mais abusivement, l'homme pouvait se croire devenu un dieu. Du moins en avait-il l'impression subjective. Au second degrĂ©, l'ivresse est le sentiment qui accompagne la jouissance de la musique, dont l'exemple est un autre vase, reprĂ©sentĂ© celui-lĂ dans un Catalogue de la BibliothĂšque Nationale (Catalogue 576), et montrant un auditeur artiste raffinĂ©, dont la tĂȘte est renversĂ©e sous l'extase qu'il ressent Ă l'audition des sons mĂ©lodieux qu'exhale sa trĂšs grande lyre. Le sens de ces deux images implique assez clairement ce qui les sĂ©pare. Les deux pĂŽles de l'ivresse comprise comme intoxication et de l'ivresse comprise comme possession divine sont Ă la base des modes qui prĂ©sidĂšrent aux divers rites, soit orgiastiques, soit extatiques.
Nous sommes lĂ partagĂ©s entre l' hybris et le sublime. NĂ©anmoins, dans les deux cas d'ivresse, se constitue l'infraction au principe d'individuation, puisque, chaque fois, l'individu sort de lui-mĂȘme : soit par l'hybris, soit par le sublime. Et Nietzsche souligne que, dans le dithyrambe dionysiaque, "l'homme est portĂ© au paroxysme de ses facultĂ©s symboliques". Est alors interprĂ©tĂ©e l'ivresse sublime du musicien raffinĂ© comme un processus d'infraction reconduisant l'individu loin profondĂ©ment au-dessous du moi empirique, jusqu'Ă l'ouverture cosmique de l'unitĂ© primitive du monde, jusqu'au centre mĂȘme de la rĂ©alitĂ© de l'univers englobant l'humain et l'extra-humain.
L'art dionysiaque ou dionysien reçoit la fonction de dĂ©livrer l'homme aussi bien de la connaissance purement rationnelle, que de l'action et de la souffrance. La volontĂ© d'illusion acquiert plus de valeur dans le sens dionysien dirigĂ© vers le profond et l'originel que la volontĂ© de vĂ©ritĂ© dans son sens courant. Et, finalement, l'art chargĂ© de vĂ©ritĂ© radicale remplace la vĂ©ritĂ© rationnelle admise depuis Socrate et qui n'est que superficielle. Pour Nietzsche, il y a coĂŻncidence entre l'art tragique et ce qu'il appelle l' "orgiasme suprĂȘme de la musique". Mais cette musique, non apollinienne, mais dionysienne, ignore peinture, description et figuration. Elle relĂšve de la vision d'un dieu "contuitif", c'est-Ă -dire qui permet de contempler de toute Ă©ternitĂ©, comme le voulait HĂ©raclite, la leçon de la loi dans le devenir et celle du jeu dans la nĂ©cessitĂ©.
Nietzsche impose le concept de "sagesse dionysienne" . Un exemple de "sagesse dionysienne" est le crime de PromĂ©thĂ©e dĂ©bouchant sur le don le plus prĂ©cieux. A l'opposĂ© de la "sagesse dionysienne", rĂšgne la "sagesse apollinienne" qui constitue, pour ainsi dire, sa symĂ©trique, mais non sa contradictoire. Ainsi, la tragĂ©die procĂšde de la "sagesse dionysienne" : elle relĂšve d'une civilisation qui ose affronter la cruautĂ© et l'ĂąpretĂ© de l'existence. Il n'en demeure pas moins que le dionysisme est en soi dĂ©vastateur. Dans la thĂ©ogonie, aprĂšs l'Ă©poque olympienne - celle-ci succĂ©dant l'Ă©poque titanesque - le culte dionysiaque, venant selon HĂ©rodote de la tribu des Satrai en Thrace, faisait renaĂźtre en GrĂšce la violence supposĂ©e avoir Ă©tĂ© propre aux temps archaĂŻques. En effet, les Titans jouent, dans la psychĂ© hellĂ©nique, la partition de la dĂ©mesure, et reprĂ©sentent dĂ©sormais l'extrĂȘme de la dĂ©mesure.
La thĂ©ogonie des Titans expose le rĂšgne d'une famille de divinitĂ©s qui dominĂšrent par la violence. Ils furent jetĂ©s dans le Tartare par Zeus. Avec l'introduction du dionysisme, les Grecs vivaient Ă nouveau cette dĂ©mesure titanique qu'ils rejetaient. Toutefois, Dionysos Ă©tait aussi essentiellement pour eux, d'aprĂšs Nietzsche, le repĂšre de la profondeur, invisible mais prĂ©sente. Ainsi, la dĂ©mesure n'est autre que la nature dĂ©chaĂźnĂ©e dans la joie et la douleur, mais aussi bien dans une connaissance qui peut ĂȘtre une vĂ©ritable Ă©preuve. La dĂ©mesure est vĂ©cue par le "choeur dĂ©moniaque des voix du peuple" qui fait d'elle une prĂ©sence illimitĂ©e, entraĂźnante, Ă laquelle s'oppose une autre prĂ©sence, attĂ©nuĂ©e, discrĂšte, celle de la mesure, Ă travers la psalmodie et les accords de l'artiste apollinien.
Mais la dĂ©mesure reçoit sa sanction : PromĂ©thĂ©e est puni de son trop grand amour des hommes. Ćdipe se trouve entraĂźnĂ© Ă commettre des forfaits : il tue son pĂšre et sa mĂšre. HomĂšre en fait le roi de ThĂšbes, mais le destin dĂ©joue le cours des existences. Dans l'inconscience qui Ă©tait celle d'Ćdipe, il Ă©tait possible de plonger dans la dĂ©mesure. N'est-ce pas le sort du hĂ©ros tragique ? Le hĂ©ros tragique reste et demeure Dionysos sous les apparences les plus diverses. Quand il n'y avait aucun personnage sur scĂšne, et que la tragĂ©die n'Ă©tait encore constituĂ©e que de son noyau, Dionysos Ă©tait le seul hĂ©ros de la scĂšne et mĂȘme l'unique personnage, mais invisible. Avec la crĂ©ation d'un, de deux, de trois personnages et plus, le hĂ©ros tragique demeure toujours Dionysos, derriĂšre l'apparence des personnages. Le personnage de Faust est, avec celui d'Hamlet, le symbole de l'homme moderne, par opposition Ă l'homme antique. D'ailleurs, il subsiste, selon Nietzsche, l'alternative pour l'Allemand son contemporain, mais aussi bien pour tout homme moderne, d'ĂȘtre soit un Faust, soit un simple philistin. Nietzsche exprime ce que signifie Faust : c'est la pensĂ©e tragique de l'homme moderne qui se serait perdu par l'aiguillon du savoir et du pouvoir conjuguĂ©s.
Selon Nietzsche, le but de la tragĂ©die attique n'Ă©tait pas d'entraĂźner la rĂ©signation, mais d'Ă©tablir la justification du mal. L'homme en tant que "dissonance incarnĂ©e" a besoin de la consolation mĂ©taphysique de la tragĂ©die, seule capable de justifier son ĂȘtre contradictoire.
D'une maniĂšre permanente, il y a pour Nietzsche dans la tragĂ©die ce qui fait pressentir la dĂ©livrance du monde. Pour Nietzsche, seul l'art peut justifier l'existence. Avec Sophocle et Eschyle, la tragĂ©die attique constitue un Ă©vĂ©nement important qui a permis que se rĂ©alisĂąt un contact priviligiĂ© : celui de l'Etre du monde avec les choses quotidiennes sous la condition de la participation profonde du spectateur. Pour Nietzsche, le rationalisme et le naturalisme d'Euripide ne pouvaient que tout gĂącher. La tragĂ©die de l'existence ne peut se trouver justifiĂ©e que dans la comprĂ©hension et dans l'assimilation de l'essence du tragique. L'extase dionysiaque repose sur l'oubli lĂ©thargique du monde des phĂ©nomĂšnes. La vue et l'audition du choeur des satyres avaient pour effet de supprimer chez le spectateur les acquis de la civilisation, les limites des lois et des institutions, ainsi que les contraintes sociales les plus diverses. C'est alors, sous l'effet de la civilisation, que l'homme "vrai" faisait son apparition, en tant qu'il serait celui qui se cache en profondeur sous le mensonge de la civilisation. L'allĂ©gresse des serviteurs de Dionysos viendrait du fait qu'ils dĂ©couvrent la connaissance de la vĂ©ritĂ© radicale, c'est-Ă -dire la nature en elle-mĂȘme. Ce que, dans Par delĂ le bien et le mal, Nietzsche dĂ©signe par l'expression homo natura (§. 230).
Ainsi, pour conclure sur le concept de l'art grec total, conçu comme apollinien-dionysien, l'art grec est, pour Nietzsche, une force de la nature mais atténuée dans sa conjonction avec la présence du Mythe. En tant que fait de civilisation, il consiste essentiellement en ce que les Grecs surent endiguer le déchaßnement naissant du savoir, au profit d'une civilisation fondée sur la tragédie. Le terrain de l'art permet la démesure qui y confond hybris et sublime, et donne le change dans la belle apparence.
________________________________________
Notes
1) Cf. A.Kremer Marietti, Nietzsche et la rhétorique, Paris, P.U.F., 1992, p.38-39, sur le rapport de la relation beau/sublime de Nietzsche à Kant.
2) Voir la Section 4 de la Naissance de la tragĂ©die: "Apollon, en tant que divinitĂ© Ă©thique, exige des siens la mesure, et, pour la pouvoir conserver, la connaissance de soi-mĂȘme"... "La dĂ©mesure se rĂ©vĂ©la vĂ©ritĂ©, la contradiction, l'extase nĂ©e de la douleur s'exprima spontanĂ©ment du cĆur de la nature".
3) Cf. Nietzsche et la rhétorique, p.160-161.
Obtenir un corrigĂ© personnalisĂ© du sujet de philosophie : La fĂȘte est-elle toujours un gaspillage ?
Vous devez traiter ce sujet ? Notre Ă©quipe de professeurs de philosophie se propose de rĂ©aliser pour vous un vĂ©ritable corrigĂ© de "La fĂȘte est-elle toujours un gaspillage ?". Votre sujet
de philo sera traitĂ© selon les indications que vous fournirez. Vous pouvez mĂȘme spĂ©cifier le dĂ©lai sous lequel vous souhaitez recevoir votre correction.
Vous recevrez votre corrigé par email, en toute simplicité, dés que votre sujet aura été traité.
Notre Ă©quipe de professeurs de philosophie se propose de rĂ©aliser pour vous un vĂ©ritable corrigĂ© de "La fĂȘte est-elle toujours un gaspillage ?". Votre sujet
de philo sera traitĂ© selon les indications que vous fournirez. Vous pouvez mĂȘme spĂ©cifier le dĂ©lai sous lequel vous souhaitez recevoir votre correction.
Vous recevrez votre corrigé par email, en toute simplicité, dés que votre sujet aura été traité.
Obtenir ce corrigé - Fonctionnement de MaPhilo.net
